Ce processus se distingue par son approche respectueuse des parties qui favorise la coopération et la recherche d’intérêts communs plutôt que l’affrontement de position traditionnel « demandes contre demandes » et souvent associé à la négociation « de marchand de tapis ». Cette pratique trouve ses racines aux États-Unis dans les années 1990.
Qu’est-ce que le droit collaboratif ?
Le droit collaboratif repose sur un principe simple : résoudre un conflit à l’amiable, toutes les parties et leurs avocats s’engagent à trouver une solution équilibrée, dans le respect des intérêts de chaque partie.
Contrairement aux procédures judiciaires classiques, qui peuvent être longues et coûteuses, cette démarche privilégie le dialogue et la coopération. Les parties concernées s’engagent contractuellement dans un processus de négociation soutenu par des avocats, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
Ce processus présente la qualité d’être cadré par cinq principes. Tout d’abord, il s’agit d’un travail en équipe, où avocats et parties collaborent étroitement pour trouver une solution équilibrée. Le recours à la juridiction est exclu, sauf pour l’homologation de l’accord final. La transparence est un élément clé, garantissant une communication ouverte entre les parties. Par ailleurs, une confidentialité renforcée est assurée tout au long du processus afin de protéger les échanges et les négociations.
Enfin, en cas d’échec des discussions, les avocats se retirent du dossier : celui qui a négocié ne pourra pas plaider devant le tribunal, garantissant ainsi l’intégrité et la neutralité du processus. Cette dernière règle permet de garantir une implication totale de tous dans la volonté de résoudre le conflit.
Ce processus présente également l’avantage d’être organisé en six étapes. Le processus commence par le récit des faits, raconté à la…






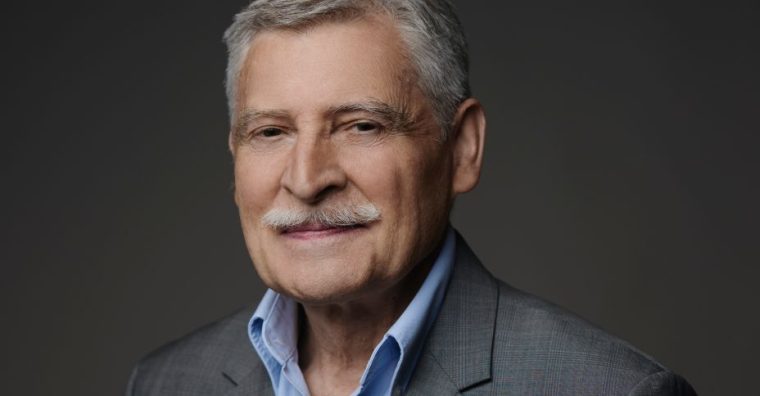
![Illustration de l'article [ Un mois, une oeuvre ] L’éveil du génie](https://www.echos-judiciaires.com/wp-content/uploads/2025/11/Ziegler_Giotto_F_Deval1_1-scaled-e1762358254604-760x396-c-default.jpg)
