La société à responsabilité limitée (SARL) s’impose, tant en droit français qu’en droit marocain comme une structure sociétale de prédilection pour les petites et moyennes entreprises. Recherchée pour la limitation de la responsabilité des associés, sa simplicité de fonctionnement et son adaptabilité, elle constitue un véhicule juridique privilégié dans un environnement économique marqué par la recherche de sécurité et de flexibilité.
Toutefois, malgré une inspiration commune – en grande partie issue du modèle juridique français – la SARL marocaine s’est progressivement détachée de ce moule originel, générant ainsi des disparités substantielles. Ces dernières affectent tant la structuration initiale, que la gouvernance, la fiscalité ou encore la transmissibilité des parts sociales. Une lecture comparative s’avère dès lors incontournable, pour éclairer les juristes praticiens sur les implications pratiques et stratégiques de chaque cadre.
La SARL marocaine s’est progressivement détachée de ce moule originel
Constitution : une souplesse partagée
La possibilité de constituer une SARL unipersonnelle – dite SARLAU en droit marocain et EURL en droit français – permet dans les deux systèmes juridiques à un entrepreneur isolé de créer une entité sans partenaire, consacrant ainsi une approche flexible de l’initiative économique.
Cependant, un écart significatif subsiste quant au nombre maximal d’associés admis : fixé à cinquante par le droit marocain[1], ce plafond s’élève à cent en droit français[2]. Ce différentiel traduit une vision plus extensive de la SARL en France, qui permet son adaptation à des configurations capitalistiques plus complexes.
Sur le plan du capital social, l’absence d’exigence d’un montant minimal, dans les deux ordres juridiques, témoigne d’une volonté partagée de démocratiser l’accès à l’entrepreneuriat. Elle facilite ainsi la création de structures légères, notamment dans les secteurs à faible intensité capitalistique.
Responsabilité
Dans les deux systèmes, les associés ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, principe fondamental garantissant une étanchéité entre le patrimoine personnel et le patrimoine social. D’ailleurs, les législations française et marocaine consacrent ce principe en des termes identiques : « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. »[3]
Les associés ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports
La portée de ce principe est essentielle : il établit une véritable cloison étanche entre le patrimoine propre des associés et celui de la société. Autrement dit, les créanciers sociaux ne peuvent exercer leurs recours qu’à l’encontre du patrimoine de la société et non contre celui des associés.[4]
Cette règle favorise ainsi l’initiative entrepreneuriale dans les deux pays en limitant les risques financiers pesant sur les associés.
Agrément de nouveaux associés
La cession des parts sociales à des tiers est strictement encadrée. En droit marocain, l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital est requis, sauf stipulation contraire des statuts. Cette règle protège la composition du capital et vise à préserver l’intuitu personae. Ainsi, le cadre marocain, plus protecteur, privilégie la stabilité du capital et la confiance entre associés, au détriment parfois de la liquidité des parts.
En revanche, le droit français se montre plus permissif, exigeant seulement la majorité des parts sociales pour valider une cession, sauf clause contraire. Cette souplesse favorise une plus grande mobilité des titres, facilitant ainsi les opérations de restructuration ou d’ouverture du capital.
Organisation de la gouvernance
Les deux systèmes autorisent la désignation d’un ou plusieurs gérants, associés ou non, ce qui offre une latitude appréciable aux fondateurs dans la répartition des rôles. Dans les deux pays, la désignation et la révocation, résultent d’une décision ordinaire.
Cependant, en matière de durée du mandat, une différence essentielle existe : en France, les statuts fixent librement la durée, tandis qu’au Maroc, si les statuts sont muets, la durée du mandat est limitée à trois ans. Cette règle traduit une volonté marocaine d’éviter les mandats indéfinis, tandis que la France fait le pari de la liberté contractuelle.
Prise de décisions collectives
La SARL au Maroc et en France présente des différences notables en matière de prise de décisions, tant ordinaires qu’extraordinaires.
– Pour les décisions ordinaires, au Maroc, aucun quorum n’est exigé sauf stipulation contraire des statuts. La majorité requise lors de la première réunion est celle d’un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette première réunion ne peut se tenir faute de quorum, une seconde réunion peut avoir lieu et dans ce cas, la majorité est déterminée en fonction des votes exprimés, quel que soit le nombre de votants.[5] En France, la règle est similaire.
– Concernant les décisions extraordinaires, la SARL au Maroc ne prévoit pas non plus de quorum, sauf si les statuts en disposent autrement. La majorité requise est celle d’un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En France, les exigences sont plus encadrées. Lors de la première convocation de l’assemblée générale extraordinaire, les associés présents ou représentés doivent détenir au moins le quart des parts sociales.[6] Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation peut avoir lieu dans un délai de deux mois, avec un quorum abaissé à un cinquième des parts sociales. La majorité nécessaire pour adopter les décisions est fixée aux deux tiers des parts sociales des associés présents ou représentés. Certaines décisions particulières, comme le changement de nationalité de la SARL,[7] exigent néanmoins l’unanimité.
Ainsi, on constate que les règles marocaines sont plus souples en matière de quorum, mais plus strictes quant à la majorité pour les décisions extraordinaires. À l’inverse, la France impose un cadre plus rigoureux pour la tenue des assemblées, mais permet une majorité plus faible pour la validation de certaines décisions importantes.
Sur le plan fiscal
Au Maroc, la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).[8] Le taux de l’IS varie en fonction du bénéfice net réalisé par la société : il est fixé à 20 % lorsque le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams (9 501 885 euros) et à 35 % lorsque ce bénéfice est égal ou supérieur à ce seuil.[9]
En France, la SARL est assujettie également à l’IS[10] dont le taux normal est fixé à 25 % sur l’intégralité du résultat fiscal. Toutefois, un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfices peut s’appliquer aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 000 000 €, à condition que leur capital soit entièrement libéré et détenu à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques. De plus, la législation française introduit une option transitoire au bénéfice de certaines petites structures, leur permettant d’opter temporairement pour l’impôt sur le revenu[11] pendant une période de cinq exercices (non renouvelable). Ce mécanisme offre une flexibilité supplémentaire en phase de démarrage ou de faible rentabilité.
Nomination du commissaire aux comptes
Le contrôle externe par un commissaire aux comptes (CAC) n’est obligatoire au Maroc que lorsque le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions de dirhams (4 750 942,50 euros) hors taxes.[12] En deçà, la nomination est facultative.
En France, l’approche est plus structurée. Deux des trois seuils suivants doivent être franchis pour rendre la nomination obligatoire : 5 millions d’euros de total bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires HT, 50 salariés. Ce système de condition tripartite permet une appréciation plus fine des enjeux de contrôle, proportionnée à la complexité de la société.
Une philosophie de régulation différenciée
La SARL demeure, des deux côtés de la Méditerranée, un outil juridique performant, conciliant flexibilité de gestion et sécurité des parties prenantes. Toutefois, le droit marocain manifeste une préférence pour la stabilité et la préservation des équilibres internes, tandis que le droit français valorise l’autonomie statutaire et la fluidité des opérations.
Ces distinctions, loin d’être anecdotiques, imposent aux praticiens du droit des affaires une vigilance rédactionnelle et une expertise comparative approfondie. Dans un contexte d’internationalisation croissante des flux économiques, cette dualité normative constitue un enjeu stratégique pour tout projet entrepreneurial transfrontalier.
[1] Art. 47 de la loi n° 5-96.
[2] Art. L223-3 du Code de commerce.
[3] Art. L221-3 du Code de commerce / Art. 44 Loi n° 5-96.
[4] Cependant on rappellera que la prudence s’impose toujours car cette étanchéité n’exclue pas l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour fautes de gestion.
[5] Art 74 de la loi n° 5-96.
[6] Art. L223-30 du code de commerce.
[7] Rare en pratique.
[8] Art. 2 du Code général des impôts marocain.
[9] Art. 19 du Code général des impôts marocain.
[10] Art 206 du Code général des impôts français.
[11] Art. 239 bis AB du Code général des impôts français ; l’IR est également en option pour les SARL dites « de famille » et les EURL.
[12] Art. 80 de la loi n° 5-96.


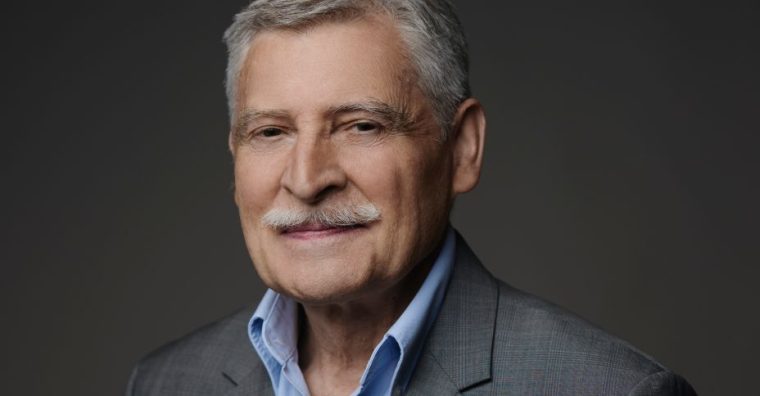
![Illustration de l'article [ Un mois, une oeuvre ] L’éveil du génie](https://www.echos-judiciaires.com/wp-content/uploads/2025/11/Ziegler_Giotto_F_Deval1_1-scaled-e1762358254604-760x396-c-default.jpg)

![Illustration de l'article [ Analyse ] La ruée vers l’or](https://www.echos-judiciaires.com/wp-content/uploads/2025/10/TRIBUNE-SEBASTIENHENINNEW-ORIGINALEIDT1-760x396-c-default.jpg)


